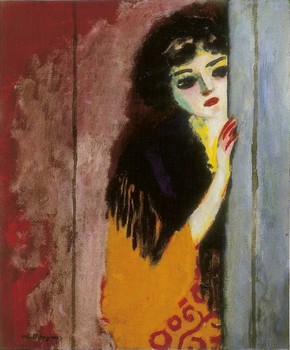Et nous voilà déjà rendus à la moitié de cette saison 7, avec du temps à tuer jusqu’à Noël. C’est assez frustrant, mais Moffat nous a fait un beau cadeau avec ce The Angels take Manhattan. Sans être parfait, cet épisode offre une belle conclusion pour les Pond, avec une narration un peu alambiquée, et des Weeping Angels qui ne m’avaient pas aussi bien terrorisé depuis Blink.
« New York. The city of a million stories. Half of them are true. The other half just haven't happened yet. »
« Statues, the man said. Living statues that moved in the dark. »
L’introduction de cet épisode est juste somptueuse. New York, les années trente, de nuit et sous la pluie, avec un détective privé, une enquête sur des statues. La voix-off, la machine à écrire, la musique grandiose… J’avais déjà des frissons dans le dos rien que pendant les trente premières secondes. Rendue au générique, je me suis carrément demandé si je survivrais à l’épisode.
Cela continue tout aussi délicieusement après le générique. Petite musique légère, mais des statues, des clignements d’œil, et le Doctor qui fait la lecture d’un roman noir en plein Central Park, Melody Malone.
« New York growled at my window, but I was ready for it. My stocking seams were straight, my lipstick was combat-ready, and I was packing cleavage that could fell an ox at twenty feet... »
Ce début d’épisode est un vrai délice, même au revisionnage : le Doctor qui lit à voix haute, Amy qui se plaint, les lunettes, la remarque sur les rides, Rory qui s’en sort merveilleusement bien sur la question. Je vous épargne tout extrait, j’en aurais cité tout le passage. Mais difficilement de faire l’impasse sur celui-là.
« I always rip out the last page of a book. Then it doesn't have to end. I hate endings. »
« As I crossed the street, I saw the thin guy, but he didn't see me. I guess that's how it began... I followed the skinny guy for two more blocks before he turned and I could ask exactly what he was doing here. He looked a little scared, so I gave him my best smile and my bluest eyes...
- I just went to get coffees for the Doctor and Amy. »
« Hello, River. »
Ça, c’est de l’intro. A ce stade, je trépignais pratiquement sur mon siège. Le jeu entre le livre qui raconte l’histoire, et nos protagonistes qui la vivent… il n’y a que Moffat pour partir dans des trips pareils. Et côté réalisation, c’est quand même superbement bien rendu.
- We're in the rest of the book.
- What?
- Page 43. You're going to break something.
- I'm what?
- "Why do you have to break mine ?" I asked him. He frowned and said : "Because Amy read it in a book and now I have no choice."
- Time can be rewritten.
- Not once you've read it. Once we know what's coming, it's written in stone.
J’avoue avoir trouvé le principe un peu bizarre cette idée. Doctor Who oscille toujours entre « Time can be rewritten » et les « Fixed point in space and time », mais globalement ces derniers temps, le Doctor s’arrangeait toujours bien pour contourner le problème du point fixe, il suffit de voir la saison 6 où tout est une question d’apparence.
D’autant plus que dans ce cas ça rend l’action des méchants de l’épisode précédent absolument absurde, puisqu’ils cherchent à faire disparaître les humains pour prévenir le futur. Vous n’allez pas me dire que dans tous les évènements qu’ils cherchent à éviter (et dont ils ont connaissance), il n’y a pas de point fixe (il y a la mort d’Adélaïde Brooke sur Mars, par exemple).
C’est un peu bizarre, en même temps la série n’a jamais été très cohérente sur la question (ne serait-ce que parce qu’elle traite parfois différemment l’Histoire avec un grand H et l’histoire des héros), et on pourrait en discuter des heures sans trouver de solution. A défaut, on peut se consoler que pour la règle ici posée, Moffat s’y tient jusqu’au bout de l’épisode.
Après une belle séance de timey-wimey (à coup de porcelaine chinoise), le Doctor et Amy arrivent à atteindre l’époque où se trouvent River et Rory.
« Just a moment, final checks. »
Le passage où le Doctor retrouve River est tordant (lorsqu’il se recoiffe), mais aussi très émouvant. Cet épisode est une rencontre assez rare, ils sont tous les deux assez âgés, et leur relation a atteint une certaine maturité.
Leurs dialogues sont plein de mordant, comme toujours, mais la façon dont se comporte Eleven avec elle est très différent. Rien que la façon dont il la frôle en passant… On reproche toujours à Moffat le manque d’émotion dans ses épisodes, mais ce genre de passage tout en subtilité, ça me file des frissons (pas de peur cette fois-ci).
- But we can't read ahead. It's too dangerous.
- I know. But there must be something we can look at.
- What, a page of handy hints ? Previews ? Spoiler free ?
- Chapter titles ?
Et toujours ce parallèle avec le livre, j’aime beaucoup. Doctor Who a toujours été une série qui parlait des histoires, des petites comme des grandes, et quand on dit histoire, on pense livre. C’est une chouette mise en parallèle, et difficile de ne pas penser au premier épisode où apparait River, Silence in the Library, qui lui aussi parlait beaucoup des livres.
Mais il est vrai qu’une partie de moi me dit que si River n’a pas encore écrit son livre, qu’est-ce qui l’empêche de changer ce passage si le Doctor ne lui brise pas le poignet. Ou plutôt qu’est-ce qui l’empêche d’avoir écrit ça en dépit du fait qu’elle ne le brise pas. Ou vu qu’elle l’a écrit après cette histoire, ne pourraient-ils pas ouvrir une page au hasard et tomber sur l’information qu’il faut, parce que c’est comme ça que ça s’est passé ? Bon il ne faut pas trop y réfléchir, la migraine me guette.
- You just changed the future.
- It's called marriage, honey.
Bon en théorie je pourrais vous parler de ce pauvre Rory qui se fait une fois de plus touché par un ange (par des bébés anges même, brrr), et qui est envoyé ailleurs, pas loin du creepy building de l’introduction, mais ce qui se passe entre River et le Doctor est nettement plus intéressant. J’aime beaucoup la façon dont elle lui ment délibérément pour lui redonner espoir, d’ailleurs pendant un instant, on y croit.
- Why did you lie to me?
- When one's in love with an ageless god who insists on the face of a 12-year-old, one does one's best to hide the damage.
- It must hurt.
- Yes. The wrist is pretty bad too.
Et le fait qu’il la soigne après, ça m’a laissé toute flagada tellement c’était trop mignon (et Eleven est tellement alien qu’on ne le voit pas souvent faire des choses aussi humaines). Et j’adore comment elle lui en colle une juste derrière avec sa main tout juste réparée !
Cela donne lieu à un très joli moment mère/fille avec Amy ensuite.
- OK, so why did you lie?
- Never let him see the damage. And never, ever let him see you age. He doesn't like endings.
Cet épisode n’est pas sans défauts, mais j’ai adoré cette façon dont toutes les relations entre les personnages atteignent leur apogée, leur maturité : Amy et Rory, le Doctor et River, River et Amy… C’est un peu triste parce que c’est le cas parce leur histoire arrive à leur fin pour presque tous (Amy et Rory bien sûr, mais aussi pour River qui ne m’a jamais semblé aussi proche de la Library), mais ça fait vraiment plaisir de voir tous ces petits échanges plein d’émotion.
Bon allez, allons plutôt faire un tour dans le creepy building.
« Why's it smiling? »
Avec toutes ces histoires de couples, j’en oublie un peu nos weeping angels dont le piège se referme peu à peu sur nos quatre héros. Et pourtant ils ont leur importance aussi.
Doctor Who est une série qui me fait régulièrement trembler, mais les Weeping Angels ont vraiment été une apothéose. Outre le fait que j’en ai fait des cauchemars, je n’oublierais jamais, le samedi où j’ai regardé Blink, le moment d’hésitation que j’ai eu en allant rendre mes livres dans une bibliothèque dans laquelle se trouve une gigantesque tête en bronze à l’entrée.
Les Silence aussi m’ont terrifié, mais pas autant. Les Weeping Angels ont cela de terrifiant qu’ils puisent vraiment dans le quotidien. Des statues, on en voit de partout.
Bizarrement le double épisode de la saison 5 m’avait moins impressionné que Blink, parce qu’il les dénaturait un peu : on les voyait bouger, ils parlaient, ils tuaient les gens au lieu de les envoyer dans le passé. Du coup ça en faisait de vulgaires tueurs, c’était moins effrayant d’une certaine façon.
Dans The Angels take Manhattan au contraire, ils redeviennent terrifiants. Déjà parce que ça se passe chez nous (le New York des années 30 est bien plus proche que le crash du Byzantium), mais aussi parce qu’on retrouve le jeu avec le spectateur qui fait partie intégrante de l’histoire : les anges ne bougent que quand la caméra ne les regarde pas.
Et, au lieu de discourir avec le Doctor, ils sourient. Un sourire vaut mille mots, je ne vous le fait pas dire, celui-là est à vous coller des sueurs froides.
Le piège des anges, c’est une forme de ferme d’élevage où au lieu d’agresser ponctuellement des passants, ils s’en prennent à la même personne de façon répétitive pour se nourrir. Un peu étrange. Discutable une fois encore, mais si je continue à réfléchir sur la question mon cerveau va freezer (j’ai été un peu traumatisée par un article lu ailleurs où l’auteur se demande si les anges emploient des livreurs de pizza pour nourrir leur « élevage »).
Ceci dit je n’avais pas vu le coup des fenêtres au premier visionnage, où on voit la même personne à des âges différents. Plutôt bien fait.
Rory n’est pas très heureux à l’idée de mourir seul dans cet immeuble, et Amy n’est pas d’accord. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l’épisode
The girl who waited où le Doctor disait à propos d’Amy
« if anyone could defeat pre-destiny, it's your wife. ». Et bien c’est un peu le cas ici, où elle combat un futur fixé pour garder son époux.
(on la comprend, qui ne voudrait pas avoir un Rory chez soi ?)
Bon soyons honnêtes, la Statue de la Liberté en weeping angel, c’est complètement gratuit, mais fun. Il faut bien qu’on puisse rigoler un peu de temps en temps, parce que le reste de l’épisode…
- Stop it. You'll die.
Yeah, twice, in the same building on the same night. Who else could do that?
Il est vraiment malin ce Rory quand même. Et tellement tragique. Oh purée je l’adore, je ne veux pas qu’il parte !
- You think you'll come back to life ?
- When don't I ?
Blasé par la mort en plus… Et sa femme est pas mal aussi dans son genre.
- What the hell are you doing?!
- Changing the future. It's called marriage.
Bon par contre, la chute au ralenti, beurk. Je ne sais pas ce qu’ont les gens avec les ralentis, moi ça me gâche systématiquement mon plaisir. Mais la musique de toute la scène est très belle (comme tout l’épisode en fait, Murray Gold s’est surpassé), ça compense.
Et pouf, tout le monde se retrouve à notre époque, dans un cimetière.
Je vous avoue qu’au premier visionnage, j’ai eu beaucoup de mal avec la fin. En fait j’étais tellement plongée dans l’épisode que j’avais perdue toute notion de passage du temps, et j’étais persuadée que j’avais encore vingt minutes d’histoire avant de dire adieu aux Pond.
Comme en plus l’ambiance est super joyeuse d’un coup, ça m’a complètement choqué de voir Rory disparaitre comme ça, pouf. Il m’a fallu un deuxième visionnage pour être vraiment affecté, et que les larmes me montent aux yeux pour le final d’Amy.
- It'll be fine. I know it will. I'll be with him, like I should be. Me and Rory together. Melody ?
- Stop it, just, just stop it !
- You look after him and you be a good girl, and you look after him.
- You are creating fixed time. I will never be able to see you again.
- I'll be fine. I'll be with him.
- Amy, please, just come back into the TARDIS. Come along, Pond, please.
- Raggedy man, goodbye !
Moffat a eu du mal à écrire la conclusion des Pond et ça se sent. Ceci dit la conclusion est logique, on savait depuis pas mal de temps qu’Amy était prête à abandonner le Doctor pour Rory, et qu’une vie normale avec Rory était préférable à voyager à travers l’espace et le temps avec le Doctor. Et elle part dans un dernier coup d’éclat, car elle modifie son histoire ainsi, et Rory ne meurt plus seul.
C’est juste un peu dommage que le « je ne vous reverrais plus jamais » semble si insatisfaisant. A priori, cela est dû au fait que les anges ont tellement affecté l’espace-temps (sans parler du paradoxe tenté par Rory et Amy) que le TARDIS ne peut plus se rendre à cette époque. Mais Et dans ce cas-là, est-ce que Martha et le Doctor dans la saison 3 n’auraient pas dû ne pas pouvoir se rendre sur place ?
Et qu’est ce qui empêche de leur rendre visite plus tard ? De les emmener et de les ramener plus tard ? C’est parce que leur histoire à eux est trop perturbée pour être visitable ? Peut-être faut-il différencier l’Histoire avec un grand H, et leur ligne temporelle à eux deux qui a déjà été sérieusement perturbée.
C’est un peu la faille dans l’histoire, mais je suppose qu’on va se contenter de se dire que c’est encore une histoire de wibbly wobbly timey wimey stuff. Le final est suffisamment fort pour qu’on laisse de côté ces considérations, de toute façon, et j’aime beaucoup comment la boucle est finalement bouclée :
« Hello, old friend.
And here we are, you and me, on the last page. By the time you read these words, Rory and I will be long gone. So know that we lived well, and were very happy. And above all else, know that we will love you always. Sometimes I do worry about you, though. I think once we're gone, you won't
be coming back here for a while, and you might be alone, which you should never be. Don't be alone, Doctor.
And do one more thing for me. There's a little girl waiting in a garden. She's going to wait a long while,
so she's going to need a lot of hope. Go to her. Tell her a story. Tell her that if she's patient, the days are coming that she'll never forget. Tell her she'll go to sea and fight pirates. She'll fall in love with a man who'll wait 2,000 years to keep her safe. Tell her she'll give hope to the greatest painter who ever lived and save a whale in outer space. Tell her, this is the story of Amelia Pond. »
« And this how it ends. »
Je pourrais m’arrêter là, mais une question m’a beaucoup travaillé quelques jours plus tard. Je ne sais pas si vous vous rappelez de
Pond Life, mini-série qui introduisant la saison 7 en mettant en scène Amy et Rory dans leur vie de tous les jours. Le cinquième épisode était très sombre et inquiétant et pas uniquement pour ce qu’il montrait de la vie des Pond.
En effet, on y voit le Doctor changer l’ampoule de la lampe sur le toit du TARDIS. Or River lui fait remarquer qu’il faudrait la changer dans The Angels Take Manhattan, et lui dit qu’il l’a fait récemment. Seulement, avec toutes leurs mésaventures, elle aurait bien pu griller une fois de plus (et River est toujours très au fait de l’état du TARDIS).
Du coup, je me demande si le Doctor qu’on voit à la fin de Pond Life ne serait pas un Doctor post séparation avec Amy et Rory. D’où le fait qu’il cherche à les contacter, mais efface finalement son message parce qu’on ne peut réécrire l’histoire.
D’ailleurs ce n’est pas la seule bizarrerie qui me pousse à penser que la chronologie du Doctor n’est définitivement pas celle de la série. Il y a aussi cette mention de Rory qui a oublié son chargeur de téléphone à l’époque d’Henry VIII dans l’épisode 3, alors que cette aventure a lieu dans l’épisode 4.
Tout cela est bien étrange. Du coup, je me demande si sous des fausses apparences d’épisodes assez simplistes, Moffat ne nous cache pas quelque chose… Affaire à suivre à Noël donc.
P.S. de dernière minute : Alors que mon article était déjà bouclé, la BBC a publié une petite vidéo,
P.S., qui éclaire le destin des Pond, et clôt également l'histoire de Brian (personnage qui manquera beaucoup), tout en faisant une jolie référence à
Blink. Ce ne sont que des storyboards et des voix, mais c'est déjà très émouvant comme ça. Ca serait tellement bien s'ils pouvaient la tourner pour de vrai pour le DVD !